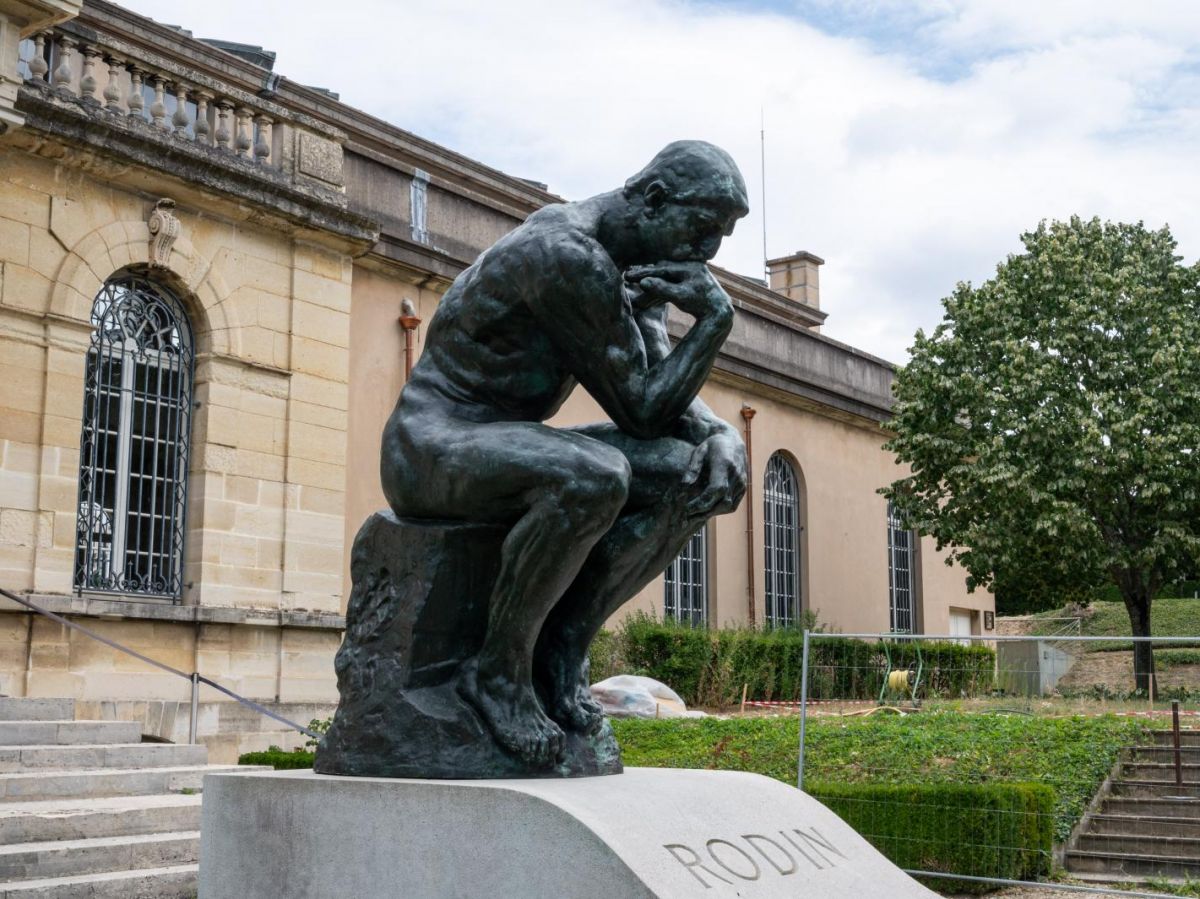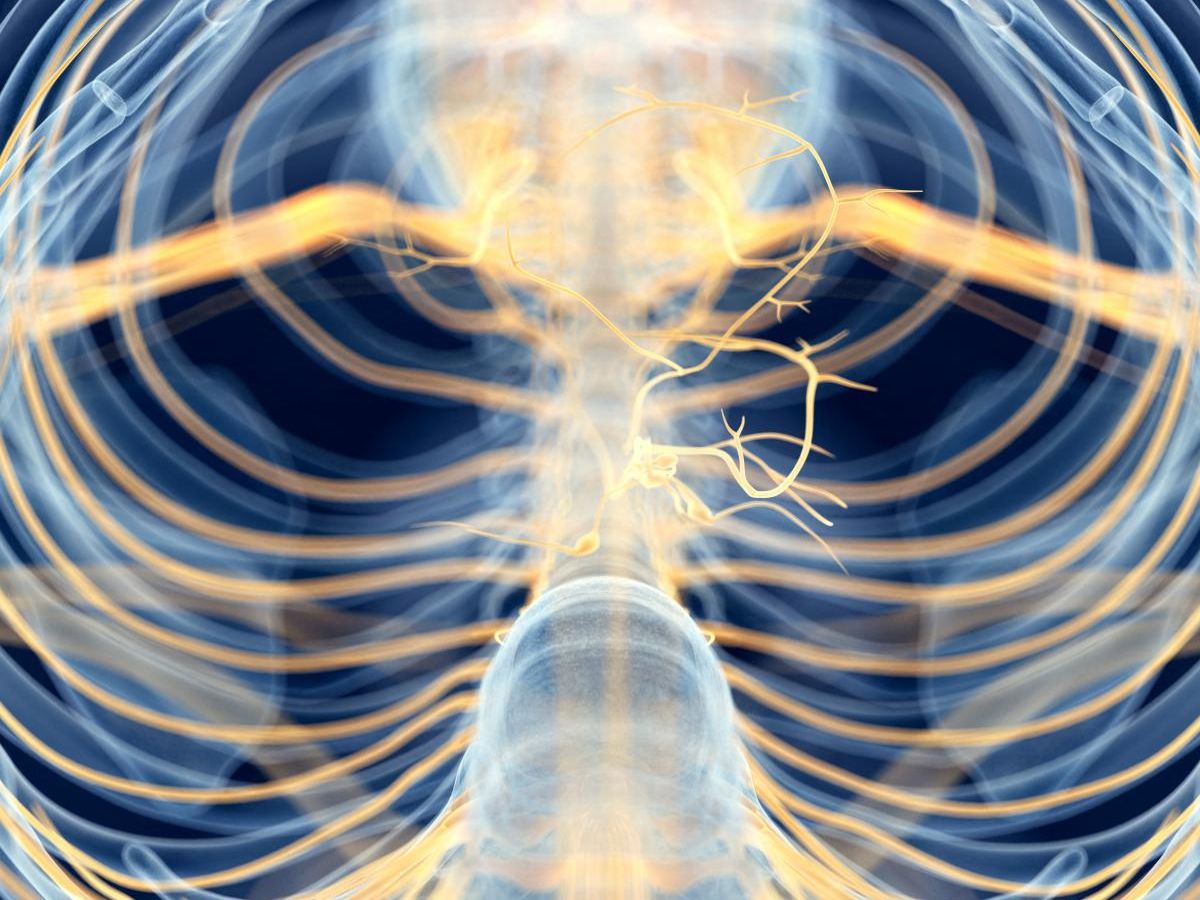« Pourquoi a-t-on tendance à croire que « ça n’arrive qu’aux autres » ? », nous demande Alpha Yeni sur notre page Facebook. C’est notre question de lecteur de la semaine. Merci à toutes et tous pour votre contribution.
Il y a une certitude à laquelle nul n’échappe, une vérité universelle que l’on apprend très tôt et que l’on répète comme un mantra pour donner du sens à l’existence : nous mourrons tous un jour. Pourtant, même si la raison nous l’assure, notre cerveau s’emploie à nous faire douter de cette évidence dès qu’il est question de notre propre personne. Car penser sérieusement à sa mort est une entreprise qui, pour beaucoup, se heurte à une sorte de mur invisible. Comme si la fin de notre vie nous concernait de loin, à la manière d’une fiction lointaine.
Le cerveau filtre la réalité pour nous protéger
Ce phénomène n’est pas qu’une coquetterie psychologique ou un défaut de lucidité : c’est un mécanisme neurologique bien documenté. Des chercheurs de l’Université Bar-Ilan (Israël) et du CNRS ont publié en 2019 une étude fascinante dans la revue NeuroImage, sur la manière dont le cerveau humain réagit lorsqu’il est confronté à l’idée de sa propre mort. Leur constat : il existe une résistance cérébrale à établir un lien concret entre « soi » et « mort ».
« Le cerveau n’accepte pas que la mort puisse nous être associée », résumait en 2019 le neuroscientifique Yair Dor-Ziderman, co-auteur de l’étude, dans les colonnes du Guardian. Cette forme de « déni automatique » se mettrait en place dès l’enfance, comme un rempart protecteur contre l’angoisse existentielle. Car associer son identité à la disparition est une pensée potentiellement paralysante pour un organisme programmé, avant tout, pour survivre.
Lire aussiBiais cognitifs : comment notre cerveau nous manipule-t-il ?
Une expérience « morbide »
Pour en avoir le cœur net, les chercheurs ont mené une expérience impliquant 24 jeunes adultes (26 ans de moyenne d’âge). Chaque participant a été exposé à des mots liés à la mort (comme « funérailles », « deuil », « enterrer ») suivis d’images : tantôt leur propre visage, tantôt celui d’un inconnu, ou bien un visage « morphé » combinant les deux. Grâce à l’électroencéphalographie (EEG), les chercheurs ont observé les réponses cérébrales à ces stimuli.
Résultat : lorsque le visage associé aux mots morbides était celui d’un inconnu, le cerveau réagissait vivement, traduisant une « surprise cognitive ». En revanche, quand il s’agissait du propre visage du participant, cette réaction était absente. Comme si le cerveau refusait d’associer « moi » et « mort » dans une même représentation mentale.
Lire aussiQue se passe-t-il dans notre corps quand on meurt ?
La mort des autres est plus facile à envisager que la nôtre
Cette dissonance cognitive est à l’origine de l’illusion bien connue selon laquelle les drames n’arrivent qu’aux autres. Comme notre cerveau est réfractaire à l’idée de notre propre fin, il projette la mortalité sur autrui. « Nous ne pouvons pas rationnellement nier que nous allons mourir, mais nous percevons plutôt notre mortalité comme quelque chose qui arrive aux autres », analysent les auteurs de l’étude.
Ce biais n’est pas sans conséquences : il nourrit l’imprudence face aux risques, le scepticisme face aux maladies graves (« ça ne me concerne pas ») et la banalisation des avertissements de santé publique. Mais c’est aussi un levier d’adaptation psychologique : sans cette barrière mentale, la conscience de notre finitude pourrait nous paralyser.
Bien avant les neurosciences, certains penseurs avaient pressenti ce mécanisme de défense. Le philosophe grec Épicure écrivait déjà, au 3e siècle avant J.-C. : « habitue-toi à la pensée que la mort n’est rien pour nous, puisque si l’on considère avec justesse que la mort n’est rien pour nous, l’on pourra jouir de sa vie mortelle ». Une invitation à ne pas fuir cette pensée, mais à l’intégrer dans une vision apaisée de la vie. Dans la même veine, environ deux siècles plus tard, le poète latin Horace formulera le fameux « Carpe diem » : « Cueille le jour présent, en te fiant le moins possible au lendemain ». Une ode à la pleine conscience de l’instant, face à l’imprévisibilité de l’existence.