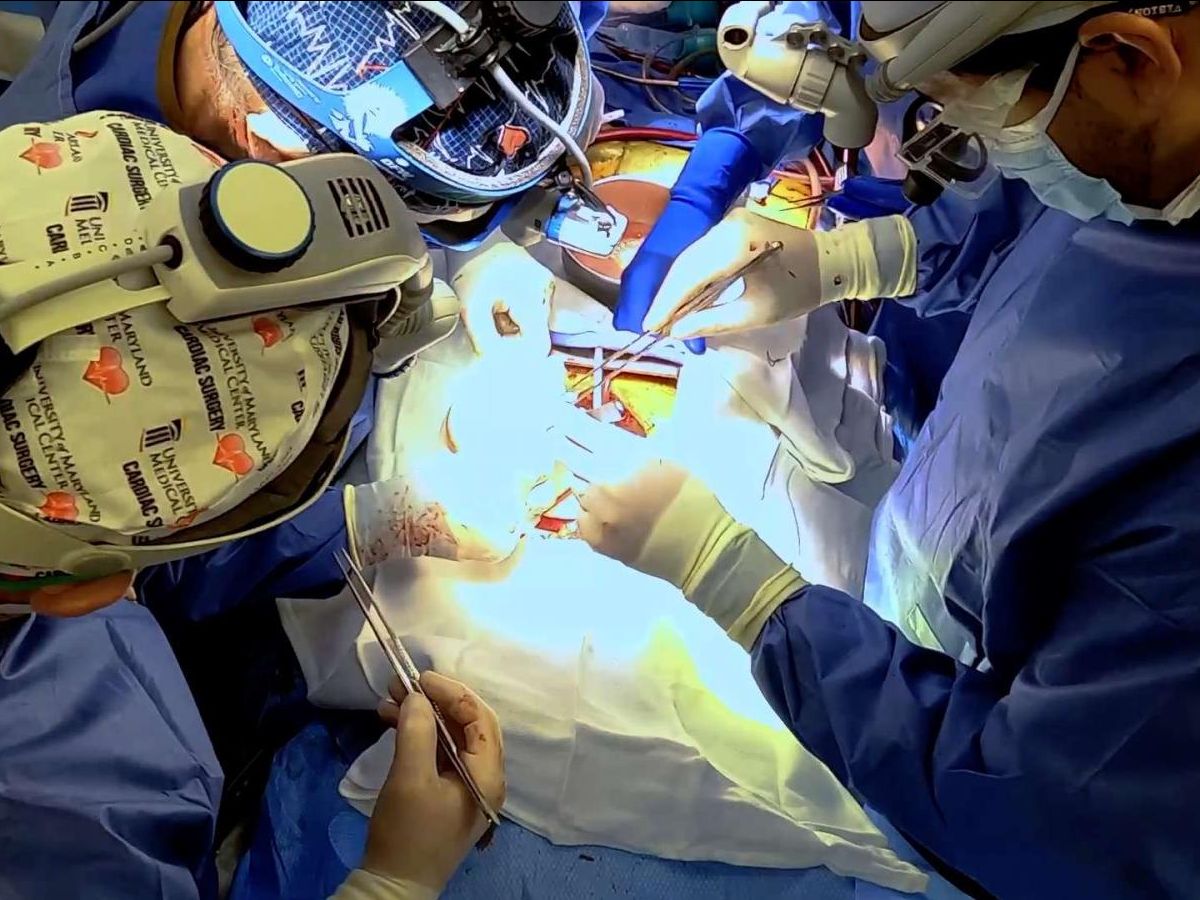Chaque année, ce sont plus de 22.000 personnes qui sont en attente de transplantation, et seulement 6.000 sont réalisées par manque d’organes, selon l’Agence de la Biomédecine. Des délais importants qui obligent certains patients à attendre jusqu’à 3 ou 4 ans, voire plus selon le type de greffe demandée, entraînant parfois le décès du malade. Pour pallier la pénurie d’organes, la xénogreffe, la transplantation de greffon d’un donneur d’espèce différente du receveur, apparaît comme une solution.
Dans le domaine de la xénotransplantation, la France a toujours été dans la course. Au début du XXe siècle, Mathieu Jaboulay greffe pour la première fois un organe de chèvre chez une femme. Quelques petites années après, le Franco-russe Serge Voronoff expérimente lui aussi la xénotransplantation en utilisant des tissus de testicules de singe chez l’homme. Des pratiques qui se sont arrêtées en raison d’échecs causés par une réponse immunologique forte, et dont l’inquiétude face aux risques de transmission de virus dans les années 1990, notamment celui du VIH, a été un découragement supplémentaire.